La migraine, ce handicap invisible
Nouveau Départ, Nouveau Travail #58 | Laetitia Vitaud
✍️ Nouveau Départ, Nouveau Travail. Voici un nouvel article de ma série “Nouveau Départ, Nouveau Travail” où je partage, par écrit, des réflexions sur les mutations du travail, inspirées par l’actualité, des expériences vécues ou mes lectures du moment. Je me suis fixé le défi de vous proposer des articles courts et percutants 💡
Certains mots paraissent trop anodins pour rendre compte de la violence de ce qu’ils décrivent. Le terme migraine en fait partie. Pour beaucoup, il évoque un simple mal de tête, un petit désagrément qu’on règle avec un cachet et un verre d’eau. Pour ceux qui n’en souffrent pas, c’est même un cliché : l’excuse trop facile pour annuler un dîner, un prétexte pour rester au lit ou éviter une réunion qui traîne en longueur. Mais pour plusieurs millions de personnes dont je fais partie, la migraine est tout sauf anodine : c’est une maladie neurologique profondément invalidante, au point de mettre la vie entre parenthèses souvent pendant plusieurs jours chaque mois.
Des formes légères qui décrédibilisent les crises sévères
J’ai souvent comparé la migraine à ce sac de 30 kilos qu’on porte en permanence. Quand la crise est légère, on continue à avancer, on travaille, on répond aux e-mails, mais on le fait en souffrant en silence, en mobilisant une énergie folle pour masquer ce qui se passe dans notre tête. C’est le quotidien de nombreux migraineux : fonctionner malgré la douleur, compenser, anticiper, tenir bon jusqu’à ce que ça passe.
Mais cette forme « gérable » de migraine contribue à décrédibiliser ceux qui, lors d’une crise plus sévère, disent qu’ils ne peuvent tout simplement pas travailler. On leur répond souvent : “Untel est migraineux aussi, et lui, il travaille.” Oui… sauf que tout dépend de la violence de la crise. Il y a les migraines légères, et il y a les migraines très, très méchantes.
Une réalité neurologique pesante au quotidien
Quand la migraine bascule dans sa forme sévère, plus rien n’est possible. Tout s’arrête. Je me retrouve au lit, immobile, dans le noir. Les allers-retours vers la salle de bain s’enchaînent, pour aller vomir, et la seule chose que je peux faire est d’attendre. Le monde extérieur cesse d’exister. Les messages et les mails doivent attendre. Contrairement à d’autres maladies, la migraine ne laisse aucune échappatoire : impossible de lire, impossible de regarder une série. Le cerveau est saturé. Il n’y a que la douleur, la nausée et l’attente.
Ce qui rend la situation encore plus difficile, c’est le décalage immense entre ce vécu et la perception qu’en ont les autres. La migraine est une pathologie extrêmement répandue : on estime qu’environ 10 millions de personnes en souffrent en France, et plus d’un milliard dans le monde. Un adulte sur sept serait concerné. Pourtant, la maladie reste largement incomprise. Elle touche de manière disproportionnée les femmes : 80 % des migraineux sont des femmes, en raison notamment de la sensibilité du système nerveux aux fluctuations hormonales. Les variations du taux d’œstrogènes amplifient les crises.
Les mécanismes de la migraine sont aujourd’hui mieux connus. Ce n’est pas une douleur imaginaire, ni le signe d’une sensibilité excessive. Il s’agit d’un dysfonctionnement neurologique impliquant une hyperexcitabilité des neurones du tronc cérébral. Lorsqu’un déclencheur apparaît — stress, variations hormonales, manque de sommeil, alcool, lumière forte, certains aliments comme le chocolat ou, dans mon cas, le lactose — une réaction en chaîne se met en place. Le cerveau libère une molécule, la CGRP, qui dilate les vaisseaux sanguins et active les nerfs responsables de la douleur. La réaction est si forte qu’elle déclenche des symptômes systémiques : douleurs intenses d’un côté du crâne, hypersensibilité à la lumière et au son, troubles digestifs, vomissements, difficultés à penser ou parler clairement. Pour certains, la vision se trouble avant même que la douleur n’apparaisse : c’est l’aura, ce phénomène neurologique qui annonce une crise.
Dans ma vie quotidienne, la migraine m’impose un mode de vie monacal. Pas d’alcool, parce que c’est un déclencheur immédiat. Une alimentation contrôlée au millimètre — pas de lactose dans mon cas. Une attention extrême au sommeil, parce qu’une nuit trop courte ou trop longue suffit à faire basculer une journée entière. Limiter le stress (pas toujours évident dans un monde professionnel qui en produit en quantité). Éviter le soleil et les surstimulations sensorielles. Faire particulièrement attention aux écrans. Tout cela ne garantit pas l’absence de crise, mais augmente un peu les chances d’y échapper.
Un handicap encore largement ignoré par le monde du travail
L’incompréhension de la part des non migraineux a des conséquences directes au travail. La migraine n’est pas vue comme une maladie invalidante dans le contexte professionnel. Difficile d’expliquer à son employeur qu’on ne sera pas là, sans risquer d’être taxée de fragilité excessive ou de manque de fiabilité. Beaucoup de migraineux vivent une double peine : la souffrance physique, et la nécessité de se justifier — parfois même d’être soupçonnés de « profiter » d’un arrêt.
« Quand je travaillais à ELLE, il y a un moment déjà, les grosses crises de migraine étaient admises et comprises. Et nous étions quelques unes à en souffrir. Dans une rédaction très féminine, personne ne remettait en cause ta douleur : si tu avais une migraine, tu ne pouvais pas travailler, point » m’a expliqué la journaliste (et migraineuse) Michèle Fitoussi, à propos de son expérience de la migraine au travail. C’est tellement plus simple quand on peut gérer son travail avec la plus grande autonomie possible. Mais les univers de travail dans lesquels les femmes sont majoritaires (et autonomes) sont-ils les seuls où les enjeux de santé des femmes peuvent être reconnus ?
Pourtant, la migraine représente une cause majeure d’absentéisme et de baisse de productivité dans le monde. Les économistes de la santé parlent d’un coût colossal : entre les arrêts maladie, le présentéisme (être là mais incapable de travailler réellement) et la perte de concentration, la migraine coûterait des milliards d’euros chaque année en Europe.
Les traitements disponibles sont loin d’être à la hauteur du problème. Les médicaments préventifs traditionnels — bêtabloquants notamment — fonctionnent chez certains patients, mais pas chez tous, et entraînent souvent des effets secondaires qui rendent leur usage difficile au long cours. Les triptans, comme le zolmitriptan, peuvent aider en crise, mais ils comportent un risque d’accoutumance et d’effet rebond : un soulagement suivi d’une nouvelle crise, souvent plus sévère. J’en ai fait l’expérience, comme beaucoup : on prend le médicament pour stopper l’enfer, et on se retrouve à vivre un enfer encore pire vingt-quatre heures plus tard.
Des progrès existent pourtant. Des traitements plus récents, notamment ceux ciblant la molécule CGRP, semblent très prometteurs. Le Vydura, par exemple, donnerait des résultats rapides et durables pour beaucoup de patients. Mais il n’est pas remboursé par la Sécurité sociale. À presque 45 euros la pilule en pharmacie, un traitement de fond reviendrait à environ 700 euros par mois par migraineux, ce qui le rend inaccessible pour la plupart des gens.
Comme me l’a confié Michèle Fitoussi, « J’ai constaté pour moi, et pour beaucoup autour de moi, que les crises violentes s’atténuent avec l’âge. Mais si l’on doit attendre la retraite pour souffler un peu… quelle perte de productivité et de qualité de vie en attendant ! » C’est rassurant de savoir que probablement, les crises de migraine seront moins sévères en vieillissant. Mais n’est-il pas absurde de laisser les migraineux traverser des décennies de souffrance évitable ?
Reconnaître, adapter, soutenir : l’urgence de la prise en compte
En serait-on là si la maladie touchait majoritairement des hommes ? L’histoire médicale laisse penser que non. L’endométriose, elle aussi longtemps minimisée, commence seulement à être reconnue comme une pathologie invalidante. Pour la migraine, nous n’avons pas encore franchi ce cap.
Reconnaître la migraine comme maladie chronique invalidante permettrait d’ouvrir des droits spécifiques : aménagements de poste, télétravail lors des premiers signes, souplesse horaire, adaptation des environnements lumineux ou sonores. Former les managers et les RH aiderait à mieux comprendre ce handicap invisible.
Investir dans la recherche et la prise en charge par la Sécurité sociale de traitements efficaces serait un gain économique immense : le coût de la prise en charge du Vydura serait vraisemblablement très inférieur au coût estimé des arrêts causés par la migraine. Le prix du traitement, négocié par la Sécurité sociale, serait nettement plus faible.
Nous sommes nombreuses (et nombreux) et nous ne méritons ni la culpabilité ni la suspicion. Nous méritons d’être entendus, crus et soutenus. Parlons, témoignons, faisons avancer la compréhension. La migraine n’est pas une « excuse ». C’est une maladie neurologique. C’est seulement en la nommant que le monde du travail pourra enfin s’adapter à celles et ceux qu’elle frappe.
🎤 Si vous souhaitez inviter Laetitia à intervenir sur les enjeux de santé au travail (et notamment de santé des femmes) et l’analyse de la hausse de l’absentéisme au travail, contactez-nous par email : conferences [a] cadrenoir.eu
Le média de la transition
“À deux voix”, nos conversations à bâtons rompus sur l’actualité
Des interviews de personnalités remarquables (écrivains, entrepreneurs…)
Des articles sur le travail et l’économie
Une vision engagée, des clefs pour aller au fond des choses
Nos abonnés : des professionnels et citoyens engagés
Des nouvelles de nos travaux et de nos projets



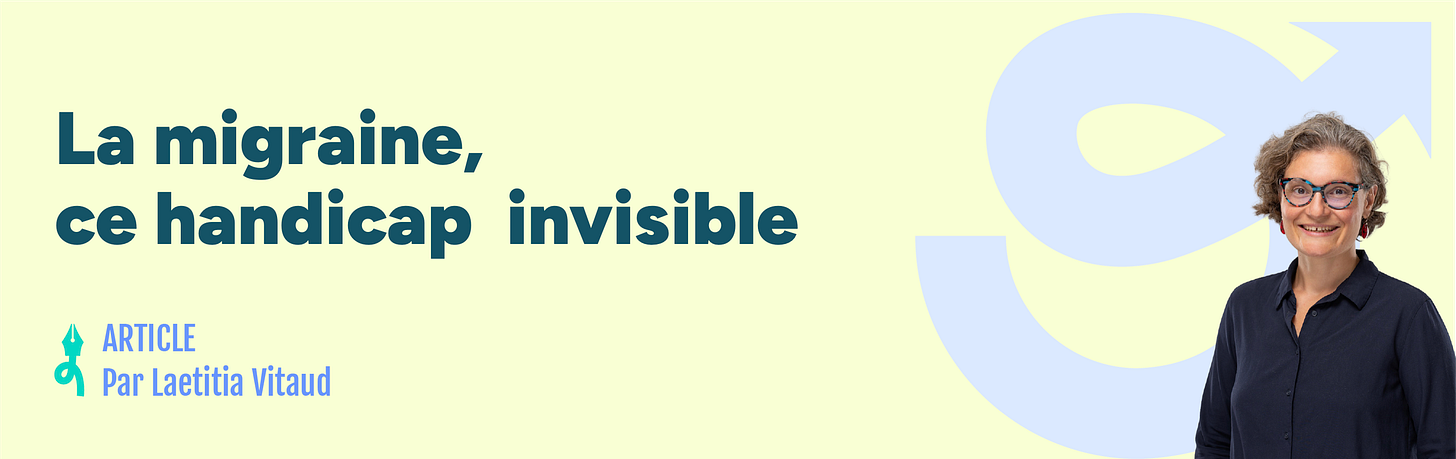
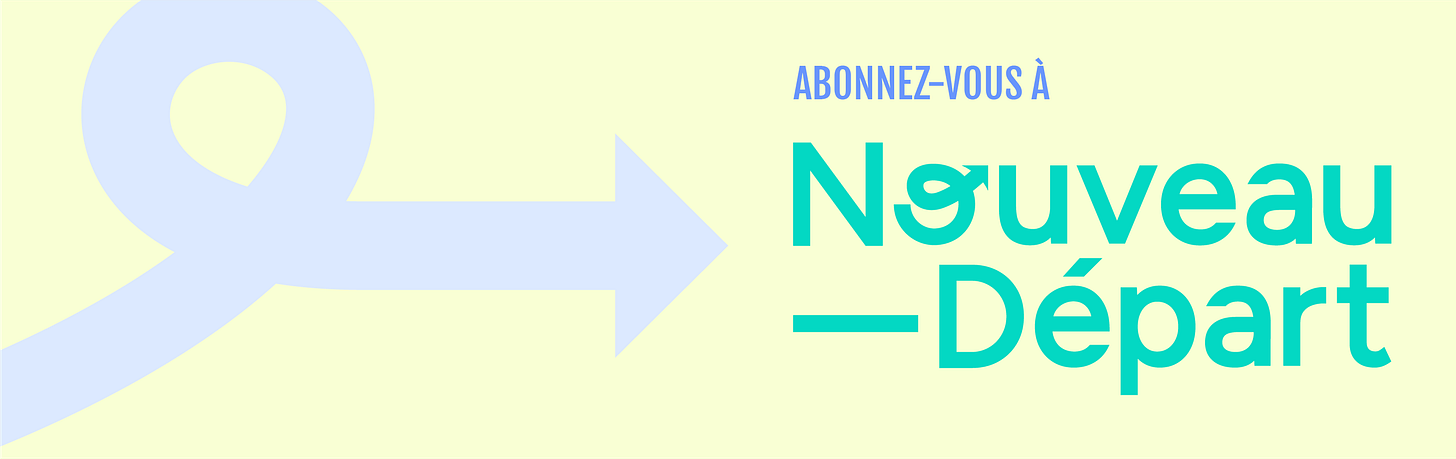
Merci d'avoir fait œuvre utile en mettant en lumière la migraine.
Un véritable sujet de société mal connu, mal diagnostiqué et mal soigné. Je reconnais les déclencheurs de crise que tu cites, les différents types de crises, avec ou sans nausées...
J'ai été migraineux pendant 30 ans et je n'ai connu le soulagement qu'avec l'arrivée des triptans. Malheureusement, avant qu'ils ne soient "génériqués", ils coûtaient une fortune. Double peine.
J'ai aussi connu les revers de l'accoutumance, les crises de rebond et celles de l'auto-sevrage : quasiment une semaine de crise !
J'ai aussi essayé, sans succès, à peu près tous les traitements de fond avec des mois d'effets secondaires pénibles la plupart du temps. Sans succès.
L'entourage a du mal à comprendre cette maladie, surtout dans un cadre professionnel où les migraineux passent pour des tire-au-flanc.
Alors, oui, il serait temps que la migraine soit socialement et médicalement reconnue comme une maladie invalidante. Et qu'elle soit mieux diagnostiquée pour être traitée.
Merci pour cet article qui parle si bien de la migraine. Difficile parfois de faire comprendre la douleur insupportable et la frustration de ne pas pouvoir continuer à faire ce qu'on a à faire... Courage aux migraineux !