Août, mois sacré : un trésor français
Nouveau Départ, Nouveau Travail #39 | Laetitia Vitaud
✍️ Nouveau Départ, Nouveau Travail. Voici un nouvel article de ma série “Nouveau Départ, Nouveau Travail” où je partage, par écrit, des réflexions sur les mutations du travail, inspirées par l’actualité, des expériences vécues ou mes lectures du moment. Je me suis fixé le défi de vous proposer des articles courts et percutants 💡
Il y a en France une tradition d’été qui résiste, contre vents et marées, à l’accélération du temps et à l’injonction permanente à la productivité : le mois d’août comme institution de repos collectif.
D’ailleurs, ce n’est pas tout à fait le mois d’août, c’est la période entre le 15 juillet et le 15 août, quand une grande partie du pays tourne au ralenti. Des commerces ferment, des services sont en pause, des boîtes mail affichent des messages d’absence. Ce qui semblait urgent quelques semaines plus tôt attendra bien septembre. Et comme c’est salutaire ! Comme un long shabbat laïque, où l’on se retrouve en famille, où les repas s’éternisent, où les siestes ne sont pas coupables, et où l’on redécouvre un rapport apaisé au temps.
C’est une particularité nationale qu’on ne retrouve pas, ou très peu, ailleurs. Ni au Royaume-Uni, ni en Allemagne, où j’ai vécu. Certes, il y a des vacances scolaires, mais rien de comparable au grand ralentissement français. Les Anglais et les Allemands répartissent leurs congés différemment, avec une organisation plus individualisée et décentralisée. En Allemagne, les vacances scolaires varient selon les Länder, ce qui empêche tout ralentissement collectif. Bref, août à la française, cette parenthèse suspendue, est une forme de luxe social et culturel.
Ce n’est pas qu’une tradition récente née des congés payés. Non, l’institution aoutienne a des racines paradoxales : c’est parce qu’on travaillait dur aux champs en été — pendant les moissons, les récoltes — qu’il fallait libérer les enfants de l’école pour qu’ils aident leurs parents. On ne partait pas en vacances, mais on travaillait ailleurs, en famille, dans les champs. Et maintenant que l’agriculture ne mobilise plus autant de bras, on a gardé les vacances… mais transformé ce temps en mois de repos, voire de glandouille assumée. Quel retournement savoureux !
Le repos est social, ou il n’est pas
Cette institution fonctionne si bien précisément parce qu’elle est collective. Tout comme les week-ends, qui sont depuis longtemps un moment de retrouvailles familiales, de rites communs, d’activités partagées. Or c’est précisément cette dimension sociale qui est régulièrement remise en question. Si on ne travaille plus physiquement comme avant, pourquoi tous s’arrêter en même temps ? Si le repos n’est que récupération cognitive, alors chacun pourrait se reposer à sa guise, non ? Fini les rythmes communs, bonjour l’ultra-flexibilité.
Sauf que l’histoire nous montre que le repos asynchrone est un échec humain. L’URSS l’a testé, à grande échelle, avec son système de nepreryvka — la « semaine continue ». Dans les années 1930, pour éviter que les machines des usines soient à l’arrêt un jour par semaine, l’économiste soviétique Yuri Larin a proposé un système de rotation : chaque citoyen avait un jour de repos différent, symbolisé par une couleur ou un emblème idéologique (épi de blé, étoile rouge, marteau et faucille…).
Résultat : un désastre. Les familles ne se retrouvent plus. Les amis ne partagent plus rien. La protestation est massive : « Que faire à la maison si ma femme est à l’usine, les enfants à l’école, et que personne ne peut me rendre visite ? Ce n’est pas un jour de repos si on est seul. » Le système a été abandonné. Et la leçon est restée : le repos, pour faire sens, doit être partagé.
Ce qu’août permet encore (quand il est respecté)
Août en France fonctionne encore, en partie, comme ce moment d’arrêt collectif. Il offre une expérience rare dans le monde moderne : être en vacances quand personne ne vous attend, quand les boîtes mail sont silencieuses, quand les deadlines sont repoussées. Ce calme ambiant diminue le stress. Il permet la déconnexion. (Même travailler en août, pour celles et ceux qui le font, peut être agréable : moins de réunions, moins de sollicitations, plus de temps pour avancer sans être interrompu·e.)
Et surtout, c’est un mois où l’on se retrouve, avec ses proches. Ce n’est pas juste une parenthèse individuelle, c’est une pause partagée, sociale. Il y a une forme de rituel, un ancrage, une mémoire collective du repos estival.
Mais cette institution est fragilisée
Petit à petit, août se fait grignoter, de tous les côtés. Les vacances scolaires sont réduites pour permettre une rentrée dès la fin août. Les enseignant·es font leur pré-rentrée de plus en plus tôt, perdant des jours de repos. Certains travailleurs, notamment dans les métiers de service ou dans la logistique, triment sans relâche (par grande chaleur) pendant que d’autres se reposent — souvent sans reconnaissance ni compensation.
Ceux qui travaillent à distance ne déconnectent plus vraiment. Les « tracances » — ce mot-valise entre « travail » et « vacances » — disent bien cette tendance inquiétante : on ne lâche plus. Même à la plage, on garde un œil sur ses mails. Même en maillot, on prend des appels.
Or, le vrai repos, celui qui régénère, suppose une forme d’abandon. Le sentiment qu’on n’est pas indispensable. Que tout peut attendre. Que l’on peut redevenir un corps, une présence, un lien — et pas seulement une productivité en veille.
Défendons notre mois d’août !
Alors qu’août approche, je dis : stop ! Défendons cette institution française. Remettons les doigts de pieds en éventail. Acceptons que tout ne tourne pas à plein régime. Et redonnons de la valeur à ces temps collectifs, où le lien est plus important que la performance.
On pourrait dire, en exagérant à peine, que le mois d’août est un patrimoine immatériel. Il mérite d’être préservé, comme on préserve les grands équilibres d’un écosystème fragile. C’est une preuve vivante que rien n’est si urgent que cela, et qu’il est possible de ralentir ensemble.
Le paradoxe, c’est que c’est parce qu’on travaillait dur autrefois qu’on a inventé cette pause — et c’est parce qu’on travaille toujours trop (mais autrement) qu’on en a encore cruellement besoin. Août, c’est notre dernier bastion contre la fatigue du monde.
Le média de la transition
“À deux voix”, nos conversations à bâtons rompus sur l’actualité
Des interviews de personnalités remarquables (écrivains, entrepreneurs…)
Des articles sur le travail et l’économie
Une vision engagée, des clefs pour aller au fond des choses
Nos abonnés : des professionnels et citoyens engagés
Des nouvelles de nos travaux et de nos projets




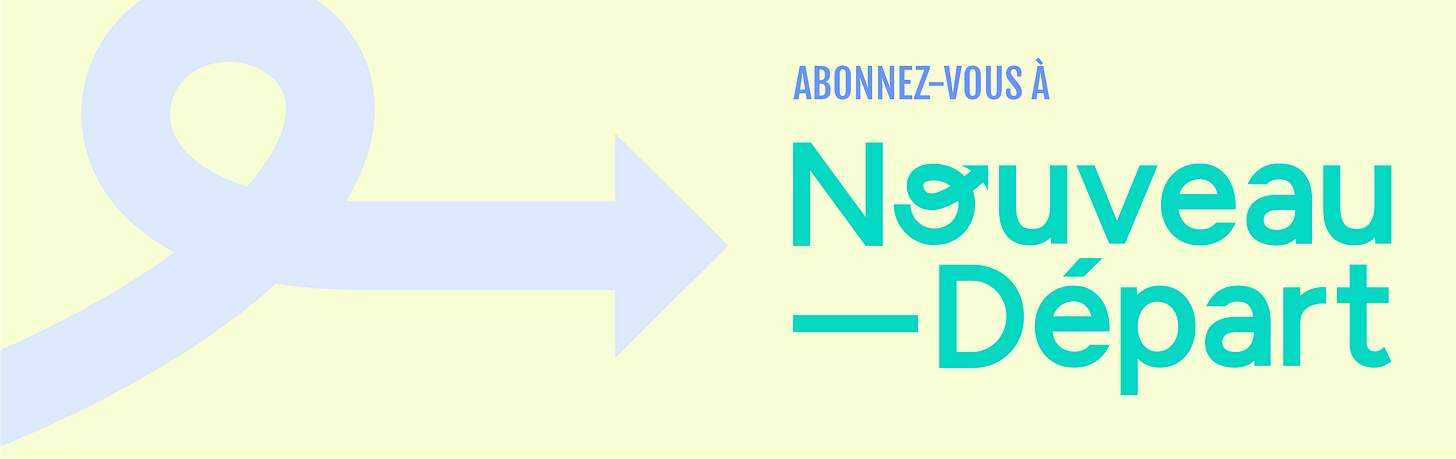
Je suis d'accord avec vos observations, mais j'aimerais ajouter quelque chose sur l'exemple de l'URSS et de la semaine continue : il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à une réorganisation aussi extrême de la société pour avoir des exemples de désynchronisation.
Quand je travaillais comme cuisinier, à part dans une boîte qui ouvrait juste le midi en semaine, je n'avais jamais samedi-dimanche comme jours de repos. Au mieux j'ai eu dimanche-lundi, mais sinon c'était plutôt lundi-mardi, mardi-mercredi... On y ajoute des horaires en coupure, c'est-à-dire en gros du 9:00-23:00 avec plusieurs heures de pause l'après-midi, souvent pas assez pour que ça vaille le coup de rentrer chez soi (à moins d'habiter vraiment juste à côté, mais se loger sur Paris avec un salaire de cuisinier ça restait quand même compliqué). Certains restaurants proposaient des horaires mixtes cependant : la moitié de la semaine en coupure et l'autre en continu (mais de toute façon, même quand j'avais ma soirée de libre, je m'écroulais dans mon lit en arrivant chez moi).
J'ai juste fait des passages éclair dans des restaurants qui étaient uniquement fermés le dimanche, et où les employés avaient par exemple mardi + dimanche comme jours de repos pour l'une, jeudi + dimanche pour l'autre etc. avec ce que ça rajoute d'inégalités entre ceux qui ont samedi-dimanche voire dimanche-lundi, et les autres. J'ai le souvenir d'un resto où le seul samedi-dimanche dispo est directement allé à la mère célibataire avec des enfants en bas âge, pour que ça reste minimum gérable pour elle, mais sinon c'était plutôt un.e employé.e avec de l'ancienneté qui s'y cramponnait.
Et là déjà, on est désynchronisé des amis et de la famille qui ont des horaires conventionnels, vu qu'on n'est dispo ni le week-end ni en soirée. Certes, on peut faire des démarches administratives ou des courses l'après-midi en semaine en n'ayant aucune attente à la caisse, mais ça reste un peu maigre comme avantage. Ou alors il faut vivre avec quelqu'un qui a des horaires décalés aussi : j'ai le souvenir d'un collègue que ça n'intéressait pas d'avoir son 24 décembre au soir de libre, car sa femme qui était infirmière travaillait de toute façon ce soir là.
Ah et j'oubliais l'effet pervers des jours de repos qui ne sont pas les mêmes d'un emploi à l'autre (sachant qu'en cuisine, "un an et demi / deux ans" c'est déjà une "collaboration à long terme") : les proches qui te finissent par te dire : "ah mais je ne me souviens jamais de tes jours de repos, du coup je suis parti.e du principe que tu n'étais pas dispo et je ne t'ai pas invité :/" 🥲🔫
Je suppose que c'est valable aussi dans les autres boîtes qui proposent un service 7j/7
Les italiens font également une grande pause au mois d’août.