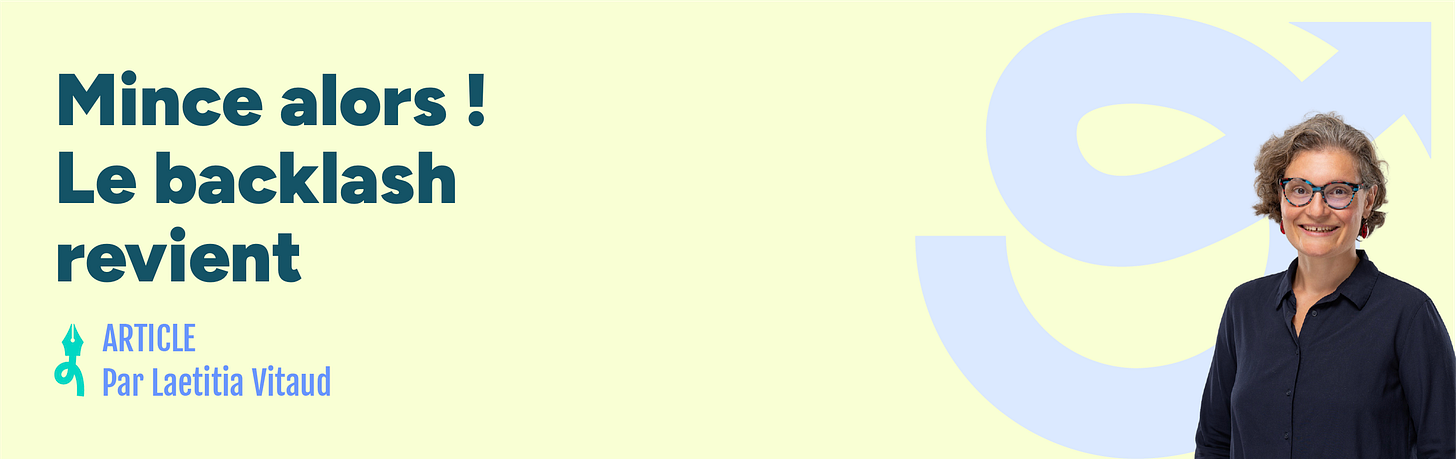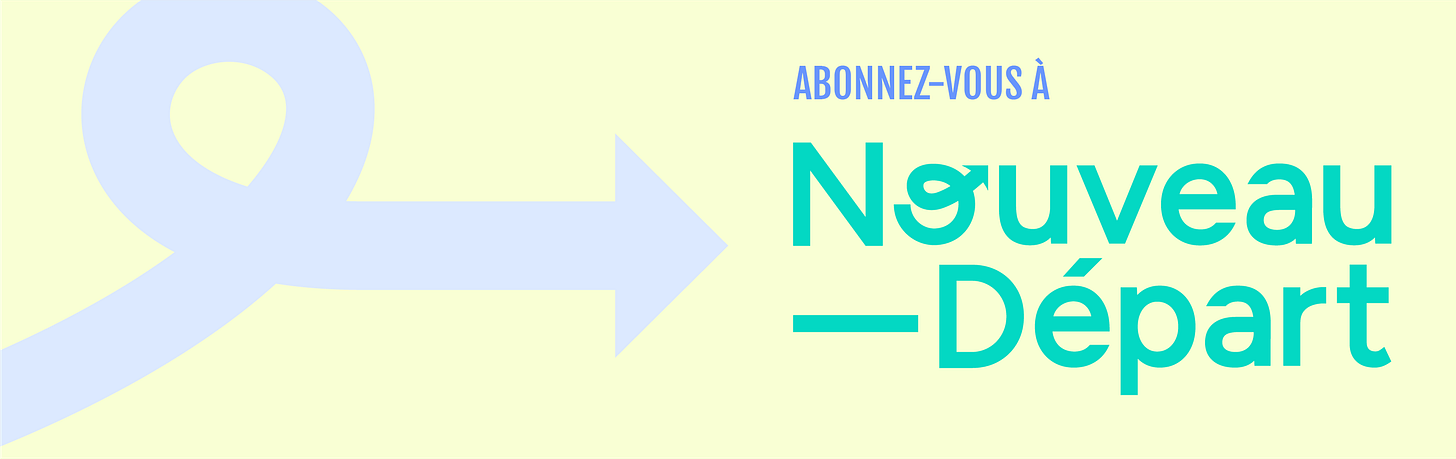Mince alors ! Le backlash revient
Nouveau Départ, Nouveau Travail #42 | Laetitia Vitaud
✍️ Nouveau Départ, Nouveau Travail. Voici un nouvel article de ma série “Nouveau Départ, Nouveau Travail” où je partage, par écrit, des réflexions sur les mutations du travail, inspirées par l’actualité, des expériences vécues ou mes lectures du moment. Je me suis fixé le défi de vous proposer des articles courts et percutants 💡
« On n'est jamais ni assez mince ni assez riche », disait Wallis Simpson, duchesse de Windsor. Cette formule cynique résonne à nouveau aujourd'hui. En 2025, alors que nous assistons à un backlash anti-féministe sans précédent, l'obsession de la minceur refait surface avec une violence inouïe, détournant l'attention et l'énergie des femmes de leurs véritables combats : l'égalité professionnelle, l'indépendance économique et le pouvoir politique.
Le retour en force d'une norme oppressante
Ce que nos adolescents entendent aujourd'hui ressemble étrangement aux injonctions des années 1990-2000 que j’ai vécues quand j’étais ado / jeune adulte. Les réseaux sociaux regorgent de contenus prônant la « discipline alimentaire », les « morning routines » axées sur le contrôle du corps, et une esthétique de la maigreur qui revient en force. Avec pour conséquence de réduire l'espace physique que les femmes occupent dans le monde.
L'alliance entre les mouvements MAGA (Make America Great Again) et MAHA (Make America Healthy Again, le crédo de Robert F. Kennedy) illustre parfaitement cette tendance. Manger sainement, faire du sport, avoir une vie bien en ordre… toutes ces injonctions sont aujourd’hui dans le mainstream républicain. Minceur, conservatisme et discipline d’acier, 3 piliers qui vont ensemble et mêlent contrôle du corps et valeurs morales. Le body positive, c’est out : pour la droite américaine, c’est à mettre dans le même sac que la DEI.
Une vieille stratégie de diversion
Derrière cette obsession se cache une stratégie aussi ancienne que redoutable : pendant que les femmes consacrent leur temps et leur énergie mentale à analyser la proportion de protéines de leurs repas, à compter leurs pas quotidiens et à optimiser leur composition corporelle, elles en consacrent moins à leur carrière, leur indépendance financière ou la défense de leurs droits.
La charge mentale liée à l'apparence est écrasante. L'anorexie est loin de reculer et 90% des personnes touchées sont des femmes, notamment adolescentes. Mais au-delà des troubles alimentaires, c'est l'ensemble de la population féminine qui subit cette pression constante d'optimisation corporelle et cette obsession.
Combien d'heures par semaine une femme consacre-t-elle en moyenne à penser à son poids, à planifier ses repas « équilibrés », à culpabiliser après avoir mangé, à analyser son reflet dans le miroir ? Combien d'énergie mentale pourrait être réorientée vers des projets professionnels, des négociations salariales, des créations d'entreprise ou des engagements politiques ?
L'histoire se répète
Cette instrumentalisation du corps féminin n'est pas nouvelle. Elle rappelle les corsets du XIXe siècle ou les pieds bandés des femmes chinoises : des pratiques qui limitaient concrètement la liberté de mouvement et, par extension, l'autonomie économique et politique des femmes. Plus elles étaient contraintes physiquement, moins elles pouvaient prétendre à l'égalité dans l'espace public.
Aujourd'hui, notre corset est mental mais il n’en est pas moins efficace. Il ne s'agit plus de comprimer la taille, mais de comprimer les ambitions. L'injonction à la minceur fonctionne comme un système de contrôle social qui maintient les femmes (et certains hommes) dans une quête perpétuelle d'amélioration corporelle, les détournant de la conquête d'espaces de pouvoir.
L'échange patriarcal : minceur contre richesse
Une croyance pernicieuse sous-tend cette obsession : l'idée que la minceur garantit la « bankabilité » sur le marché hétérosexuel et l'accès à la richesse par alliance plutôt que par le travail. Cette logique patriarcale suggère qu'une femme peut « acheter » sa sécurité financière avec son apparence physique (sa jeunesse et sa minceur) plutôt qu'avec ses compétences professionnelles.
Cette vieille idée continue de détourner les femmes de l’investissement dans leur capital humain et professionnel. Pourquoi se former, négocier ou entreprendre, quand on peut « simplement » être mince et séduisante ? Présentée comme une voie plus directe vers la réussite, cette fausse alternative maintient les femmes dans une dépendance économique durable et freine leur potentiel d’émancipation. La misogynie trumpienne et le phénomène des tradwives illustrent bien cette régression : le principal « capital » des femmes reste leur corps. L’échange économique fondamental demeure, dans bien des cas, un échange économico-sexuel : l’accès au corps des femmes contre une sécurité matérielle — un toit, un revenu, un statut.
Cette logique est mise en scène avec une cruelle lucidité dans Materialists, le film de Celine Song sorti en juillet 2025 (pas un grand film mais l’un des 3 films à l’affiche cet été avec Pedro Pascal dedans !) qui explore les normes du marché amoureux dans une société obsédée par le capital — qu’il soit économique ou esthétique. Dans cet univers new-yorkais (cf Sex & the City) où l’amour se négocie comme une transaction, les femmes « bankable » sont jeunes, minces et belles, tandis que les hommes doivent être riches (et si possible, grands). Les hommes ont souvent vingt ans de plus que leurs partenaires : ils achètent la jeunesse et la beauté.
Reprendre le contrôle
L'ère d'Ozempic n'a pas libéré les femmes de cette pression. Au contraire, elle l'a intensifiée. Comme le note cette tribune du New York Times, certains milieux conservateurs critiquent même ces traitements au motif qu'ils ne requièrent pas de « self-control », cette fameuse maîtrise de soi érigée en vertu morale.
Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. L'algorithme privilégie les critères les plus étroits de beauté féminine comme prérequis à la visibilité. Résultat : même les femmes qui tentent de porter des messages professionnels ou politiques se trouvent contraintes de soigner leur apparence physique pour être entendues.
Face à ce backlash, ouvrons les yeux. Comprendre que l'obsession de la minceur n'est pas un choix personnel innocent, mais un système qui détourne les femmes (et de nombreux hommes) de leurs véritables intérêts économiques et politiques.
Oui, c’est bien de faire du sport et de faire attention à sa santé. Mais il faudrait remettre en question cette énergie disproportionnée consacrée par les femmes à l'optimisation de leur corps. Tant qu’elles resteront prisonnières de cette quête de la maigreur, elles continueront de prendre moins de place dans les conseils d'administration, les parlements, les directions d'entreprise et tous les lieux de pouvoir économique et politique.
Au final, le plus gros backlash anti-féministe des années 2020 n'est peut-être pas dans les discours explicitement anti-féministes, mais dans ce retour en force d’un culte assumé de la maigreur qui détourne les femmes des combats pour l'égalité.
Le média de la transition
“À deux voix”, nos conversations à bâtons rompus sur l’actualité
Des interviews de personnalités remarquables (écrivains, entrepreneurs…)
Des articles sur le travail et l’économie
Une vision engagée, des clefs pour aller au fond des choses
Nos abonnés : des professionnels et citoyens engagés
Des nouvelles de nos travaux et de nos projets