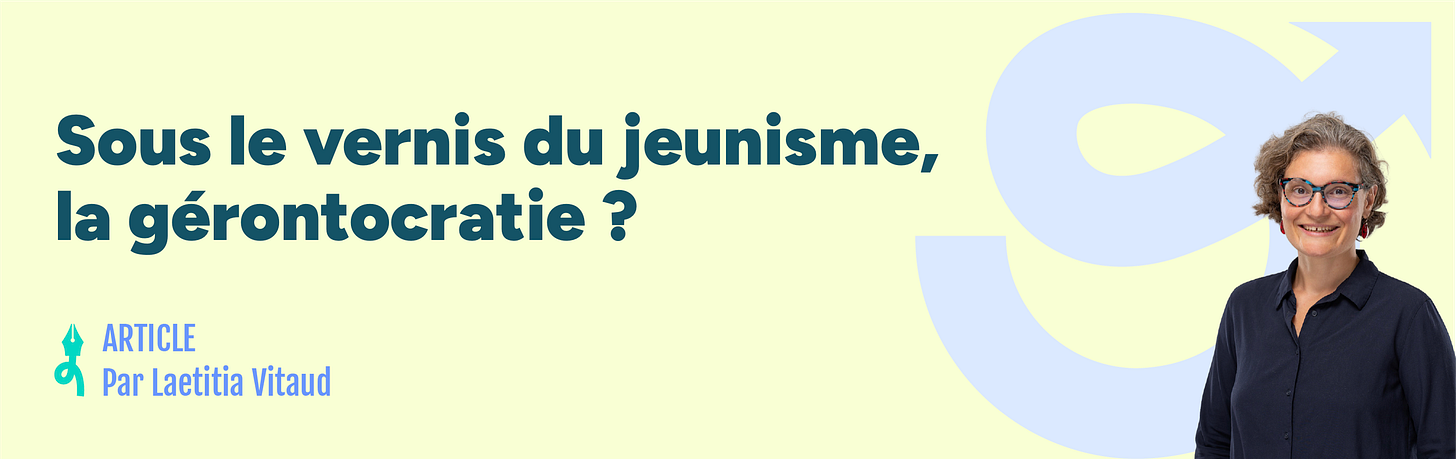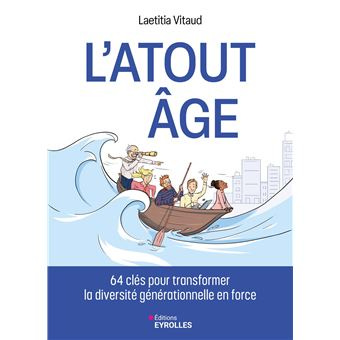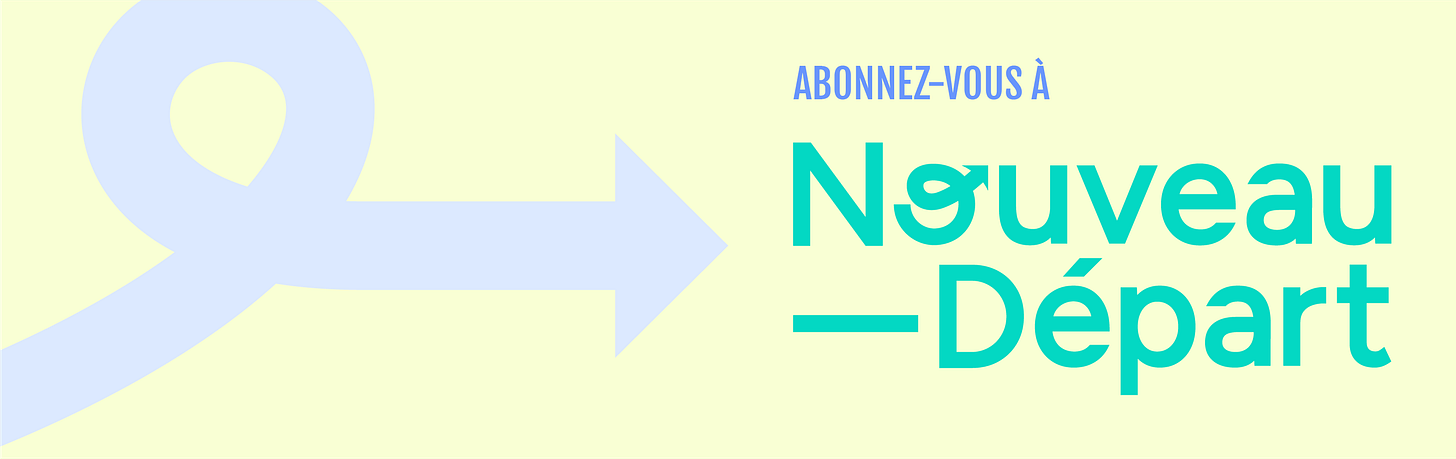Sous le vernis du jeunisme, la gérontocratie ?
Nouveau Départ, Nouveau Travail #56 | Laetitia Vitaud
✍️ Nouveau Départ, Nouveau Travail. Voici un nouvel article de ma série “Nouveau Départ, Nouveau Travail” où je partage, par écrit, des réflexions sur les mutations du travail, inspirées par l’actualité, des expériences vécues ou mes lectures du moment. Je me suis fixé le défi de vous proposer des articles courts et percutants 💡
Le mot gérontocratie a quelque chose de provocateur. Il peut sembler hostile envers les plus âgés. Et pourtant, si j’ai envie de l’utiliser à propos de la France, c’est parce qu’il évoque une société qui se fige, fermée aux plus jeunes, où les positions se transmettent bien plus qu’elles ne se conquièrent.
Ce n’est pas tant la présence d’aînés au pouvoir qui pose problème, que la dégradation de la mobilité sociale et l’impossibilité d’accumuler du patrimoine par le seul travail. Quand le capital, les postes et les décisions se concentrent entre les mains des générations plus âgées, et que les plus jeunes n’accèdent plus qu’à la marge aux leviers économiques ou politiques, le mot gérontocratie devient pertinent.
Et ce qui rend la situation paradoxale, c’est que cette gérontocratie se dissimule sous un vernis de jeunisme. On parle sans cesse de la « génération Z » ou des « jeunes générations ». On dirait qu’on érige la jeunesse en idéal, mais on lui laisse peu de pouvoir réel (autre que symbolique).
Une gérontocratie désigne à l’origine un système où les anciens détiennent le pouvoir au nom de leur expérience. Dans le cas présent, le terme s’applique plutôt à une société déséquilibrée, où les générations plus âgées s’accrochent à l’essentiel des ressources, du patrimoine et des postes de décision. En France, cette logique se manifeste à la fois dans le pouvoir économique, patrimonial et politique. C’est très naturel : tant qu’on est en vie et qu’on a envie, pourquoi laisserions-nous ce pouvoir aux plus jeunes ? Si en plus, on est censé travailler plus longtemps avant de partir à la retraite, ils risquent de devoir attendre leur tour de plus en plus longtemps.
(Attention : parler de gérontocratie ne veut pas dire que tous les vieux ont le pouvoir, mais seulement que celui-ci est largement concentré entre des mains qui ne sont plus jeunes.)
Accumuler sans hériter : mission impossible ?
Le patrimoine des ménages reste très concentré entre les mains des plus âgés. L’immobilier, qui représente 62 % du patrimoine total, s’accumule tout au long de la vie et atteint un maximum entre 50 et 75 ans. Début 2021, le patrimoine médian s’élevait à 232 800 € pour les 60-69 ans, contre 20 400 € pour les moins de 30 ans. Les seniors sont massivement propriétaires : 70 % d’entre eux possèdent leur résidence principale, souvent sans emprunt, leur endettement ne représentant que 1,3 % de leur patrimoine brut. Plus d’un sur deux (53 %) a déjà reçu un héritage.
Le patrimoine s’accumule donc chez les générations plus âgées, tandis que les jeunes générations restent locataires, souvent dans des conditions précaires. Or, sans patrimoine, il est plus difficile d’entreprendre, d’investir, ou même de se projeter.
Certes, les jeunes hériteront à leur tour — au décès de leurs parents ou via des donations —, mais ils héritent plus tard que leurs aînés. Et surtout, les inégalités patrimoniales se sont creusées en quelques générations : être héritier ou ne pas l’être ne mène plus du tout à la même vie, alors qu’autrefois, on pouvait espérer accumuler un patrimoine conséquent grâce aux seuls revenus de son travail.
Le pouvoir économique ne se renouvelle pas assez ?
Les grandes entreprises françaises restent largement dirigées par une élite vieillissante. L’âge moyen des PDG du CAC 40 est d’environ 58 ans, et dans la haute fonction publique, les postes clés sont souvent occupés par des responsables ayant dépassé la cinquantaine. Il faut du temps pour gravir les échelons et atteindre le pouvoir de décision — parfois tellement de temps que le renouvellement générationnel devient quasi inexistant.
Cette inertie ne concerne pas que les grandes entreprises : syndicats, universités, médias… partout, les postes de responsabilité sont détenus par les mêmes générations. Il n’y a évidemment rien d’illégitime à ce qu’une personne expérimentée dirige. Le problème, c’est l’absence de rotation et le verrouillage des postes. Pendant que les insiders vieillissent et conservent les positions stables, les nouveaux entrants — stagiaires, jeunes diplômés, CDD, intérimaires, prestataires ou pigistes — enchaînent les contrats précaires. Les « vrais » postes se font rares, jalousement gardés par ceux qui sont déjà dedans.
Une société qui ne renouvelle plus ses élites finit tout simplement par se scléroser.
Le poids politique des seniors est prépondérant
Côté politique, le constat est le même. La moyenne d’âge des députés français est de 49 ans, celle des sénateurs dépasse 60 ans, et les gouvernements successifs confient les postes clés à des quinquagénaires ou sexagénaires. On a même connu deux Premiers ministres septuagénaires. En parallèle, l’électorat vieillit. En 1974, à l’arrivée de Valéry Giscard d’Estaing, un quart des électeurs avaient plus de 60 ans. En 2024, ils représentent plus d’un tiers du corps électoral — et surtout, ce sont eux qui votent le plus. Les jeunes, eux, s’abstiennent davantage.
Résultat : le poids politique des générations âgées dépasse même leur poids démographique. Ce déséquilibre se reflète dans les priorités publiques : stabilité, retraites, préservation du patrimoine, bien avant éducation, jeunesse ou transition écologique.
Les jeunes ont aujourd’hui un sentiment d’impuissance politique. Leur voix pèse peu face à des générations plus nombreuses, plus mobilisées et mieux représentées. Contrairement aux baby-boomers à leur époque, ils ne font tout simplement pas le poids.
La gérontocratie européenne
La gérontocratie concerne aussi les institutions européennes. Les institutions vieillissantes sont dirigées et administrées par des élites qui ont connu l’âge d’or de la construction européenne, mais peinent à s’ouvrir aux générations suivantes. Alors que moins d’un fonctionnaire de la Commission sur cinq a moins de 40 ans, l’Union confie à une ancienne secrétaire générale septuagénaire le soin de réfléchir à la modernisation de son administration… y compris à l’usage de l’IA. Et pourtant, la relève ne manque pas : des dizaines de milliers de jeunes candidats attendent désespérément un concours bloqué depuis 2019, impatients de servir un projet collectif qui, sur le papier, devrait leur appartenir autant qu’à leurs aînés.
Une culture jeuniste paradoxale
Ce qui est fascinant, c’est que la gérontocratie cohabite avec un discours permanent de valorisation de la jeunesse. Les entreprises veulent des jeunes « agiles ». Les politiques font mine de s’adresser à la « génération Z ». Les médias cherchent des visages jeunes.
Mais ce jeunisme n’est que cosmétique. Il valorise la jeunesse comme une image — symbole d’énergie, de nouveauté — mais pas comme un pouvoir. Les jeunes sont invités à s’exprimer, pas à décider. On a l’illusion d’une société « ouverte à la jeunesse », alors même que ses structures de pouvoir vieillissent.
Relançons l’ascenseur générationnel
Le constat d’une gérontocratie ne doit pas être un procès contre les plus âgés, mais une invitation à rééquilibrer les pouvoirs. Comment donner plus d’opportunités, de responsabilités et de moyens aux jeunes ?
Voici quelques pistes :
offrir plus de postes stables (CDI) en début de carrière ;
associer les jeunes aux décisions, dans les conseils d’administration et les institutions locales ;
mener une politique du logement ambitieuse, pour permettre aux jeunes générations d’accéder à un logement décent ;
investir massivement dans l’éducation, à tous les niveaux, car c’est le meilleur levier d’égalité et d’émancipation ;
favoriser la rotation dans les postes de direction, en limitant les mandats successifs et en développant le mentorat pour transmettre le relais ;
et surtout, les écouter vraiment, pas seulement les mettre en scène.
Valoriser la jeunesse, c’est d’abord reconnaître que le pouvoir économique, politique et patrimonial reste aujourd’hui concentré chez les générations plus âgées. Pour que les jeunes puissent peser sur l’avenir, il faudrait cesser de les cantonner à un rôle symbolique ou décoratif et leur donner enfin quelques clés du pouvoir (de tous les pouvoirs).
👉 Pour aller plus loin, lisez mon livre L’Atout âge. 64 clés pour transformer la diversité générationnelle en force (Eyrolles). J’y explore les liens entre l’âge et le travail autour d’une question fondamentale : pourquoi, alors que nous vivons plus longtemps et que les générations se multiplient, continuons-nous à valoriser presque exclusivement les trentenaires au travail ?
🎤 Si vous souhaitez inviter Laetitia à intervenir sur le futur du travail à l’aune de la démographie, les générations au travail ou le travail des jeunes, contactez-nous par email : conferences [a] cadrenoir.eu
Le média de la transition
“À deux voix”, nos conversations à bâtons rompus sur l’actualité
Des interviews de personnalités remarquables (écrivains, entrepreneurs…)
Des articles sur le travail et l’économie
Une vision engagée, des clefs pour aller au fond des choses
Nos abonnés : des professionnels et citoyens engagés
Des nouvelles de nos travaux et de nos projets