Combien valent cinq ans de vie ?
Nouveau Départ, Nouveau Travail #46 | Laetitia Vitaud
✍️ Nouveau Départ, Nouveau Travail. Voici un nouvel article de ma série “Nouveau Départ, Nouveau Travail” où je partage, par écrit, des réflexions sur les mutations du travail, inspirées par l’actualité, des expériences vécues ou mes lectures du moment. Je me suis fixé le défi de vous proposer des articles courts et percutants 💡
On a l’habitude de juger la santé d’une économie avec un petit tableau de bord bien rodé : croissance du PIB, taux de chômage, inflation, création d’entreprises. Aux États-Unis, ces chiffres ont longtemps servi de preuve éclatante de puissance et de dynamisme. Avec un PIB qui reste le premier du monde, une monnaie qui reste la référence planétaire, un chômage (encore) bas (malgré le “Big Freeze” d’aujourd’hui) et un écosystème entrepreneurial unique, les États-Unis aiment se regarder comme un pays riche.
Mais qu’est-ce qu’ « être riche » ? L’est-on vraiment si l’on vit de cinq à dix ans de moins que les habitants des autres pays développés ?
C’est là le paradoxe américain : malgré sa puissance économique, les États-Unis ont vu leur espérance de vie reculer brutalement ces dernières années. Et elle était déjà plus basse que dans les autres pays « riches ». Elle est aujourd’hui d’environ 77 ans, soit près de 10 ans de moins que le Japon, 5 ans de moins que la moyenne de l’OCDE, et moins que la plupart des pays européens. Si l’on corrige nos mesures de richesse par le temps de vie, les États-Unis ne sont pas la nation la plus prospère : c’est peut-être la plus chère à vivre… et la plus coûteuse en vies perdues.
Quand la vie disparaît des radars économiques
Les économistes savent qu’une partie de la richesse ne se mesure pas dans les transactions monétaires. Ils parlent de « biens non marchands » ou de « capital humain ». Pourtant, les indicateurs phares de l’économie mondiale continuent d’ignorer une donnée pourtant fondamentale : la durée de la vie elle-même.
C’est comme si l’économie n’avait rien à voir avec le fait d’être en vie. On comptabilise le nombre de voitures produites, le prix du mètre carré ou la capitalisation boursière d’Apple, mais pas les années d’existence gagnées ou perdues. Or une vie écourtée réduit non seulement le bonheur individuel et familial, mais aussi la production, la consommation, l’innovation, l’investissement… bref, tout ce qui alimente la machine économique.
Or, aux États-Unis, cette machine va s’essouffler en allant à l’encontre de la santé publique. Il ne fait pas beaucoup de doutes que la vision trumpienne de l’économie est particulièrement délétère pour la santé.
Une espérance de vie menacée de plus belle
Après un siècle de progression continue, l’espérance de vie américaine a reculé brutalement entre 2019 et 2021. Depuis, elle s’est très peu relevée. Et les tendances actuelles laissent craindre un avenir plus sombre.
Car depuis huit mois, Donald Trump est revenu à la Maison Blanche et ses choix politiques fragilisent directement la santé publique :
Le CDC (Center for Disease Control) et d’autres agences fédérales ont été privés de financements. Ses dirigeants les plus compétents ont été virés ou on démissionné. La surveillance épidémiologique, déjà insuffisante, est désormais affaiblie. Les statistiques publiques en matière de santé seront désormais défaillantes.
La lutte mondiale contre les épidémies via USAID a été arrêtée, au moment même où des flambées de rougeole et de diphtérie font leur réapparition sur le sol américain.
Les droits et la santé gynécologique des femmes sont attaqués, avec des restrictions qui augmentent déjà la mortalité maternelle. Les médecins texans, par exemple, craignent tant d’être poursuivis en justice qu’ils sont freinés dans leurs vélleités de sauver les femmes qui ont des grossesses à problème.
La défiance vaccinale est entretenue par un discours politique qui confond science et opinion partisane. Le niveau scientifique du mouvement MAHA de Robert Kennedy Jr, c’est du niveau des influenceurs masculinistes sur TikTok. (Avec ces âneries répétées sur les vaccins et l’autisme).
La liste est incomplète mais une chose est certaine : les Américains risquent non seulement de vivre moins longtemps, mais aussi de voir réapparaître des maladies qu’ils croyaient disparues.
Cinq ans de vie, combien ça vaut ?
Oser donner un prix à la vie choque (moi la première, je trouve ça inacceptable de mettre un prix sur une année de vie). Mais ignorer la valeur des années perdues est peut-être plus choquant encore.
Certains économistes se sont posé la question et ont élaboré plusieurs outils pour tenter de la chiffrer :
La “Value of a Statistical Life” (VSL), utilisée par les agences américaines, tourne autour de millions de dollars.
Les QALY (Quality-Adjusted Life Years) attribuent une valeur monétaire à une année de vie en bonne santé. Dans de nombreux pays, on retient une fourchette de 50 000 à 100 000 $ par année.
Pour 330 millions d’Américains, cela représente donc à la louche des centaines (des milliers !) de milliards de dollars de richesse humaine potentiellement perdue, comparée aux pays de l’OCDE où l’on vit 5 ans de plus.
À titre de comparaison, le PIB annuel des États-Unis est d’environ 28 000 milliards de dollars. Autrement dit, la perte d’années de vie équivaut à des années de PIB. Vu sous cet angle, la prétendue « richesse » américaine apparaît sous un jour très différent.
Imaginons un PIB ajusté par la santé
On pourrait avoir un indicateur qui intègre non seulement la production matérielle, mais aussi l’espérance de vie, la mortalité infantile, la qualité des années vécues. Certains organismes y travaillent déjà depuis des décennies :
L’Indice de Développement Humain (IDH) des Nations unies combine revenu, espérance de vie et éducation.
L’OCDE a développé son Better Life Index, qui inclut la santé et la satisfaction de vie.
Mais ces indicateurs restent périphériques, peu repris dans le débat politique et médiatique. C’est comme si on les voyait comme le fruit de doux rêveurs « pas sérieux ». Le PIB, lui, continue de régner en maître comme le chiffre qui juge de la bonne ou mauvaise santé d’une nation.
Si on adoptait un PIB corrigé des années de vie, les États-Unis chuteraient dans le classement mondial. Et certains pays européens, voire émergents, apparaîtraient bien plus « riches » qu’on ne le pense aujourd’hui.
La double peine : crise sanitaire et stagflation
Jusqu’ici, on aurait pu dire : « au moins, l’économie américaine tourne. » Mais même cela risque fort de ne plus être aussi vrai. Depuis quelques mois, les signaux économiques virent au rouge :
La stagflation s’installe, combinant ralentissement économique et inflation persistante.
L’indépendance de la Réserve fédérale est remise en cause par la Maison Blanche, alimentant une défiance des marchés.
La confiance mondiale dans le dollar s’effrite, avec un risque de contagion financière rappelant l’effondrement argentin.
Autrement dit : même si l’on mettait de côté les vies perdues, l’économie américaine s’avance vers une crise majeure. Mais une fois qu’on les remet dans l’équation, c’est une faillite totale — sanitaire, économique et politique.
👉 L'IA nous mène-t-elle tout droit à la stagflation ? 🎧
La première richesse, c’est être vivant
Réduire l’économie à la seule production monétaire, c’est comme mesurer la performance d’une entreprise sans regarder si ses salariés tombent comme des mouches ou si ses clients meurent prématurément. Cela n’a aucun sens.
Le paradoxe américain — plus riche que tous en dollars, mais plus pauvre que beaucoup en années de vie — met en évidence l’absurdité de nos indicateurs.
En France aussi, nous discutons du budget, de la dette, du coût des dépenses publiques… sans jamais intégrer ce que valent les années de vie gagnées ou perdues. Quand un gouvernement coupe des fonds dans la prévention, l’hôpital, la santé environnementale ou la recherche, combien cela coûte-t-il ?
Car chaque mois ou chaque année de vie perdue, ce sont aussi des impôts qui ne seront pas payés, de la richesse qui ne sera pas créée. Autrement dit, l’austérité sanitaire finit par creuser une dette invisible plus lourde que la dette comptable qui obsède nos débats.
Par exemple, combien coûtent, en années de vie perdues, d’éventuelles politiques publiques qui sacrifient la santé au nom de la rigueur budgétaire ?
La richesse, c’est d’abord être vivant.
Le média de la transition
“À deux voix”, nos conversations à bâtons rompus sur l’actualité
Des interviews de personnalités remarquables (écrivains, entrepreneurs…)
Des articles sur le travail et l’économie
Une vision engagée, des clefs pour aller au fond des choses
Nos abonnés : des professionnels et citoyens engagés
Des nouvelles de nos travaux et de nos projets



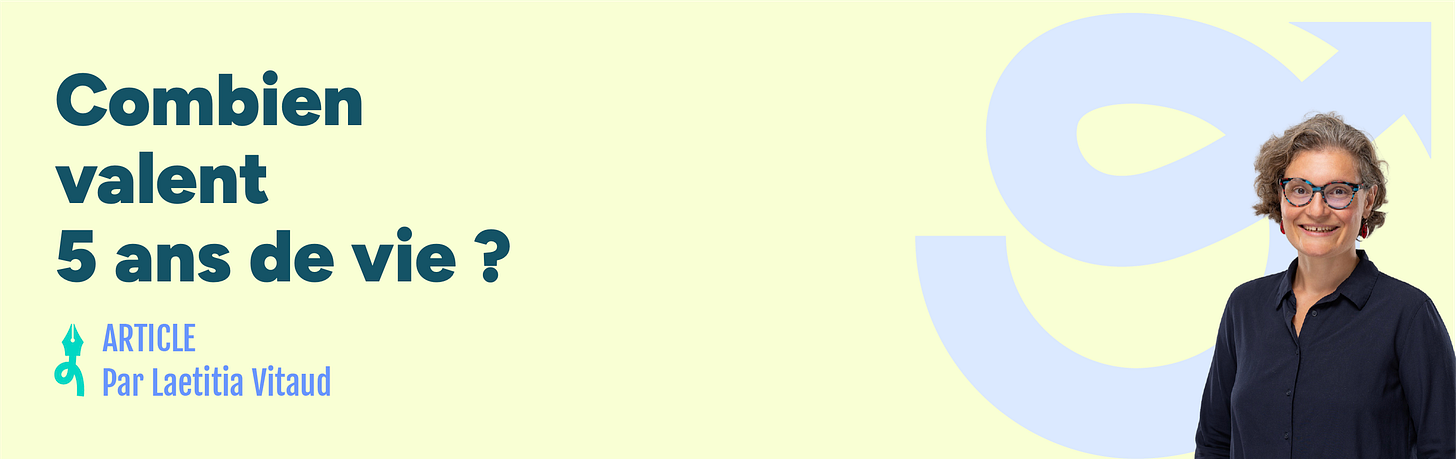

Merci Laetitia, ça alimente directement mes réflexions en cours : l’investissement dans la santé des travailleurs et leurs conditions de travail est plus souvent considérée comme un coût, et ce tu proposes est un super angle pour démontrer le ROI de ces sujets…